Produits ménagers et greenwashing : le guide pratique.
- L’Équipe Terra di Natura - Expertise & Rédaction

- 6 sept. 2025
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 déc. 2025
Lessives “révolutionnaires”, tablettes lave-vaisselle “écologiques”, sprays “naturels”... Aujourd’hui, toutes les marques de produits ménagers veulent se donner une image responsable. Mais derrière les slogans et les packagings aux couleurs de la nature, se cache parfois une autre réalité bien moche : celle du greenwashing.

Le consommateur pense acheter un produit respectueux de l’environnement, alors qu’il contient encore des substances fortement toxiques et nocives pour les milieux aquatiques.
Dans cet article, je vous explique ce qu’est le greenwashing, comment il se manifeste dans les produits ménagers, et surtout, comment l’éviter pour consommer mieux.
Qu’est-ce que le greenwashing ?
Le greenwashing, ou “écoblanchiment”, désigne une stratégie marketing qui consiste à se donner une image écologique trompeuse. Dans les produits ménagers, cela se traduit souvent par l’utilisation de termes vagues comme “éco”, “naturel”, “green” ou “respectueux de la planète”... sans preuves solides derrière.
Selon l’ADEME et la CMA (Royaume-Uni), une allégation environnementale doit être claire, vérifiable et proportionnée. Dire qu’une lessive est “écologique” alors qu’elle contient des ingrédients toxiques pour la vie aquatique ou que seul son emballage est recyclable, c’est du greenwashing.
L’objectif est de rassurer le consommateur, tout en masquant l’impact réel du produit. Un abus qui mine la confiance et ralentit la transition vers un vrai ménage responsable.
Les tactiques de greenwashing les plus fréquentes
Le greenwashing prend souvent des formes répétitives dans l’univers des produits ménagers :
L’emballage au premier plan : la marque met en avant son carton recyclable ou compostable, mais passe sous silence une formule toujours chargée en tensioactifs irritants ou polluants pour l’eau.
Les mots vagues : “d'origine naturelle”, “respectueux de la planète”, et les mentions "sans" (paraben, phtalates, etc.) qui masquent d'autres ingrédients aussi, voire plus problématiques. Autant de termes qui ne disent rien sur la composition réelle, mais qui embrouillent le client en donnant une image clean et responsable.
Les images trompeuses : feuilles, fleurs, paysages verdoyants sur les packagings donnent l’illusion de naturalité.
Les chiffres sans contexte : “- 50 % d’émissions de CO₂” mais sans préciser si cela concerne la fabrication, le transport ou l’usage du produit.
Le label détourné : mettre en avant un logo crédible (ex. FSC pour le carton) tout en laissant croire qu’il s’applique à la formule entière.
Le saviez-vous ?
L’ADEME (Agence de la transition écologique) déconseille l’utilisation de termes absolus comme “100 % écologique” ou “zéro impact”, impossibles à prouver et donc considérés comme trompeurs.
Des marques à surveiller
En 2023, la CMA britannique a épinglé plusieurs marques pour allégations environnementales trompeuses.
Pourtant, beaucoup d’acteurs de la grande consommation adoptent encore des stratégies similaires :
Les géants du secteur (Ariel, Persil, Skip…) lancent des “capsules éco” ou des “formules vertes”, mais les compositions restent proches des versions classiques : agents blanchissants optiques, tensioactifs sulfonés, parfums de synthèse.
Les marques de niche marketing misent sur l’emballage carton “compostable” ou les recharges “zéro plastique”, mais ajoutent des parfums allergènes ou des colorants inutiles qui fragilisent leur discours.
Certaines enseignes jouent aussi sur le flou du “97 % d’origine naturelle” : un chiffre séduisant, mais qui masque souvent 3 % d’ingrédients problématiques (conservateurs ou stabilisants).
Attention aussi aux marques qui prônent des formules "révolutionnaires"! Certaines marques n'ont même pas honte d'afficher des discours écologistes sur leur site, ni d'afficher la composition problématique de leurs produits en jouant la carte de la transparence. (Rappel : pour être efficace, un bon produit ménager n'a pas besoin d'ingrédients nocifs).
Quels sont les ingrédients toxiques dans les produits ménagers
Derrière certaines promesses se cachent des ingrédients dont l’impact sur l’environnement ou la santé est loin d’être anodin. Voici les principales familles de composants problématiques, avec leurs effets et ce qu’il faut surveiller.
1. Les tensioactifs agressifs
Les tensioactifs sont omniprésents : lessives, liquide vaisselle, nettoyants sols, tout en contient. Or certaines molécules posent un réel problème.
Par exemple, les nonylphénols éthoxylés (NPE) sont connus pour se transformer en nonylphénol, un perturbateur endocrinien dans les milieux aquatiques. Ces tensioactifs peuvent avoir une faible biodégradabilité, s’accumuler dans les eaux, et perturber les chaînes alimentaires. À surveiller : les mentions comme “alkylbenzène sulfonate”, “nonylphenol ethoxylate”, “tensioactif cationique” ou “quaternary ammonium compound”.
2. Les phosphates et nutriments en excès
Autre grande famille : les phosphates, anciennement très présents dans les lessives et les liquides vaisselle. Lorsqu’ils sont rejetés dans les cours d’eau, ils entraînent un phénomène d’eutrophisation : prolifération d’algues, dépérissement des plantes aquatiques, baisse de l’oxygène et mort d’animaux aquatiques. Même si de nombreuses formules ont réduit les phosphates, certains produits peuvent encore en contenir ou utiliser des nutriments équivalents. À surveiller : “phosphate”, “polyphosphate”, “tripolyphosphate”.
3. Les agents de blanchiment et solvants chlorés
Les formules “puissantes” utilisent encore des composés comme l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) ou des solvants pétrochimiques. Ces substances sont non seulement irritantes pour la peau ou les voies respiratoires, mais peuvent aussi réagir dans l’eau ou lors de l’usage pour former des composés chlorés persistants et toxiques. À surveiller : “hypochlorite”, “chlorine bleach”.
4. Les parfums, colorants et microplastiques cachés
Beaucoup de parfums synthétiques contiennent des phtalates ou d’autres substances suspectées de perturber le système hormonal ou d’être persistantes dans les eaux.
Les colorants optiques (agents blanchissants optiques) ne nettoient pas vraiment, mais donnent l’illusion du blanc éclatant : non biodégradables, ils peuvent s’accumuler.
Microplastiques : certains produits ménagers peuvent contenir de très fines particules plastiques ou verres de polymères, qui passent les stations d’épuration et finissent dans les cours d’eau.
À surveiller : le terme "parfum" seul, qui ne précise pas l'origine est bien souvent un parfum synthétique, toxique; irritant ou allergène.
5. Les substances PFAS et composés persistants
Certaines familles chimiques, comme les PFAS (substances per-et poly-fluoroalkylées), sont extrêmement persistantes dans l’environnement et peuvent se retrouver dans les produits ménagers, directement ou en sous-produit. Elles ne se dégradent pratiquement pas, contaminent les sols, l’eau et la chaîne alimentaire, et sont progressivement réglementées.
À surveiller : “PFAS”, “perfluoro…”, “fluoro… surfactant”.
Tableau comparatif : Ingrédients toxiques et alternatives responsables
Famille d’ingrédients toxiques | Exemples concrets (INCI) | Risques / impacts | Alternatives responsables | Pourquoi c’est mieux ? |
Tensioactifs pétrochimiques irritants ou polluants | Alkylbenzène sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, C12-18 Pareth-7 | Biodégradabilité faible, toxicité aquatique, irritations cutanées | Tensioactifs d’origine végétale (Coco-Glucoside, Decyl Glucoside) | Biodégradables, doux, non toxiques |
Nonylphénols éthoxylés (NPE) | Nonylphenol Ethoxylate (NPE) | Perturbateurs endocriniens pour la faune aquatique | Savons saponifiés à froid, glucosides naturels | Impact moindre sur les milieux aquatiques |
Agents blanchissants optiques | Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Agents de blanchiment optiques | Très persistants, polluants, non biodégradables | Percarbonate de sodium, bicarbonate | Biodégradation rapide, efficacité réelle sans résidus |
Solvants pétrochimiques | Propylene Glycol, Butoxyethanol | Irritations pulmonaires, pollutions des eaux, produits réactifs | Vinaigre blanc, alcool végétal, eau chaude | Pouvoir dégraissant naturel, faible impact |
Parfums de synthèse | Fragrance/Parfum (non détaillé), Limonene, Linalool synthétique | Allergènes, phtalates potentiels, pollution de l’air intérieur | Huiles essentielles (si tolérées), hydrolats, ou absence de parfum | Moins irritant, meilleure tolérance, transparence |
Colorants synthétiques | CI 42090, CI 19140, colorants azoïques | Aucun intérêt nettoyant, risques allergiques, pollution | Aucun colorant ou pigments minéraux non toxiques | Pas de pollution inutile, produits plus “propres” |
Quats et ammoniums quaternaires | Benzalkonium Chloride, Quaternium-15 | Antibactériens agressifs, résistances microbiennes, toxicité aquatique | Vinaigre, percarbonate, tensioactifs doux | Élimination efficace sans générer de résistances |
PFAS (Forever Chemicals) | PTFE, Fluoro-surfactants | Ultra persistants, contaminants des eaux, risques sanitaires | Formules sans fluorés, savon noir, tensioactifs végétaux | Non persistants, sûrs pour l’environnement |
Phosphates / agents eutrophisants | Sodium Tripolyphosphate | Dégradation des écosystèmes aquatiques (algues, mortalité poissons) | Carbonate de sodium, acide citrique | Nettoyants efficaces sans impact sur les eaux |
Microplastiques et polymères filmogènes | Polyquaternium-7, PEG-xx, acrylates | Pollutions invisibles, accumulation dans les océans | Formules sans polymères, agents naturels | Sans résidus persistants dans l’environnement |
Comment repérer un vrai produit plus responsable ?
Face au greenwashing, il est possible d’adopter quelques réflexes simples pour séparer les promesses marketing des engagements concrets.
Lire la fiche de sécurité (SDS/CLP) : si le produit est nocif pour la vie aquatique, ce n’est pas un détail. Ces mentions obligatoires donnent une image plus réaliste que les slogans.
Astuce : les produits avec des couleurs fluos sont souvent des produits hyper chimiques et toxiques. Il en est de même pour ceux qui vantent des parfums persistants ou longue durée.
Privilégier les formules simples : moins il y a d’ingrédients, plus elles sont compréhensibles. Une lessive avec 5 à 10 composants clairs et sans nom à rallonge inspire plus confiance qu’une liste interminable de solvants, enzymes et additifs.
Vérifier les labels crédibles : EU Ecolabel, Ecocert ou Nature & Progrès sont bien plus fiables que des mentions vagues de type “green” ou “naturel”.
Observer le dosage : un produit concentré peut être un vrai atout… à condition que le dosage soit clair et adapté pour éviter le surdosage.
La clé ? S’informer, lire les étiquettes, chercher les preuves et bannir les promesses vagues.
Où trouver des produits garantis sans greenwashing?
Terra di Natura a vu le jour précisément pour répondre à cette question.
Pendant des années, on a laissé les marques jouer avec les mots, maquiller leurs compositions et profiter de la confiance des consommateurs.
Nous avons créé cette boutique éthique pour offrir l’inverse : un espace sûr, lisible, où l’on peut acheter sans devoir analyser chaque étiquette pendant vingt minutes.
Cosmétiques, hygiène, produits ménagers, soins pour animaux, accessoires : chaque produit passe par une sélection stricte : composition vraiment clean, absence d’ingrédients problématiques, transparence totale des fabricants et cohérence environnementale. Si un doute existe, le produit ne rentre pas.
Aujourd'hui, Terra di Natura est la seule boutique qui vous garantit des compositions propres, des soins et produits formulés pour respecter les peaux les plus sensibles, tout en préservant la planète.
Envie d'en savoir plus ? Découvrez la boutique.
FAQ : Produits ménagers et greenwashing
Pourquoi le secteur des produits ménagers est-il particulièrement vulnérable au greenwashing ?
Le marché des produits ménagers est très sensible aux attentes écologiques des consommateurs. Or, l’impact environnemental majeur ne réside pas uniquement dans l’emballage, mais dans la formule chimique, le dosage, l’usage (température de lavage, dilution), et la biodégradabilité. De plus, la réglementation ne contrôle pas toujours toutes les allégations de façon homogène, et certaines marques utilisent des campagnes marketing efficaces, plus que des transformations profondes. Le consommateur se retrouve ainsi trompé, et l'impact environnemental reste le même, bien que l’emballage ou le discours suggère le contraire.
Que peut-on faire en tant que consommateur pour soutenir une vraie transition vers un ménage responsable ?
En tant que consommateur, vous avez un rôle actif :
Choisir des marques qui sont transparentes sur leur composition, leur origine, leur impact.
Privilégier des produits conçus pour une efficacité à basse température, une faible dose, des formules biodégradables et des emballages réutilisables ou rechargeables.
Utiliser des produits simples comme le savon de Marseille, le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate de soude. Ces produits polyvalents sont ultra efficaces, bon marché, et sans danger pour l'environnement.
Se méfier des produits "révolutionnaires", comme les feuilles de lessive soit- disant biodégradables, en lisant les ingrédients. (Astuce : si la liste contient des mots vagues ou trop compliqués à lire, c'est que ce n'est pas bon pour vous ni pour la planète 😉)
En agissant ainsi, vous à une consommation réellement responsable, et vous exercez une pression constructive sur l’industrie pour qu’elle change.
Pourquoi certaines lessives “naturelles” contiennent encore des ingrédients toxiques pour les milieux aquatiques ?
Même lorsqu’une lessive se présente comme naturelle, écologique ou respectueuse de la planète, il arrive qu’elle contienne des ingrédients puissants qui peuvent être toxiques pour les milieux aquatiques. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :
Les tensioactifs et agents de blanchiment classiques restent très utilisés car ils offrent un pouvoir nettoyant élevé. Or, certains tensioactifs comme les alkylbenzènesulfonates ou les C12-18 Pareth-7 sont reconnus comme perturbants pour les organismes aquatiques, et leur biodégradabilité est limitée.
Les allégations naturelles ne couvrent pas la totalité de la formule. Une marque peut mettre en avant un emballage recyclable ou un parfum végétal, mais la base de la formule reste conventionnelle, avec des agents chimiques peu respectueux de l’environnement.
La réglementation autorise encore certains compromis. Par exemple, des blanchissants optiques ou des conservateurs synthétiques peuvent être présents, et seuls certains labels vérifient l’impact aquatique et la biodégradabilité dans le cycle d’eau.
Le “green-look” masque souvent une formule peu transformée : un produit peut réduire le plastique d’emballage ou proposer des couleurs douces et des mots rassurants, mais cacher un impact environnemental réel encore élevé : C'est l'attrape-nigaud par excellence...
Comment vérifier si une marque de produits ménagers est réellement transparente sur ses ingrédients ?
Voici un ensemble de critères concrets pour évaluer la transparence d’une marque et aider le consommateur averti à faire un choix éclairé :
Liste INCI/ingrédients complète et accessible : la marque doit publier la liste des ingrédients clairement, idéalement sur la fiche produit et/ou dans un document de sécurité (SDS). Cela permet de vérifier l’absence d’ingrédients controversés.
Fiche de sécurité ou mentions d’impact environnemental : l’existence de données comme “nocif pour la vie aquatique”, “effets à long terme”, ou “non biodégradable” sont des signaux que la formule est soumise à un examen sérieux.
Transparence sur les critères de sélection de la formule et de l’emballage : la marque doit expliquer ses choix (origine des ingrédients, pourcentage végétal, absence de substances concernées, choix des emballages recyclables ou rechargeables).
Communication claire et non-floue : attention aux termes vagues (“origine naturelle”, “respectueux de l’environnement”) sans données chiffrées ou précises. Une marque transparente évite les superlatifs non vérifiables.
En appliquant ces critères, le consommateur peut distinguer les marques qui affichent une réelle démarche de transparence de celles qui se contentent d’un discours « écologique » superficiel.
Les labels écologiques sur les emballages garantissent-ils la naturalité de la formule ?
Les labels écologiques peuvent être de bons repères, mais ils ne garantissent pas systématiquement que la formule est entièrement “naturelle” ou sans impact environnemental. Voici pourquoi :
Chaque label a un périmètre et des critères propres : par exemple l’EU Ecolabel pour détergents et produits de nettoyage définit des exigences sur la formule, la biodégradabilité, les effets aquatiques et l’emballage. Mais toutes les marques n’y adhèrent pas ou ne répondent pas à tous les critères “naturels”.
Un label peut porter sur l’emballage plutôt que sur la totalité de la formulation : certaines marques valorisent un emballage “recyclé” ou “compostable”, mais la formule reste avec des ingrédients synthétiques ou peu biodégradables. Le label ne couvre pas nécessairement tous les composants.
Les termes marketing comme “naturel”, “eco”, “vert” ne sont pas tous réglementés : un produit peut afficher « 97 % d’origine naturelle » ou “emballage compostable” tout en ayant 3 % d’ingrédients problématiques ou peu transparents.
Une marque sans label peut être plus fiable qu’une marque avec label peu exigeant si elle pratique une vraie transparence, publie ses ingrédients, discute de ses choix et assume son impact.
En somme : un label écologique est un bon signal mais pas une garantie absolue. Il doit être combiné à une lecture critique de la composition, de la formulation, et à une marque qui pratique la transparence.







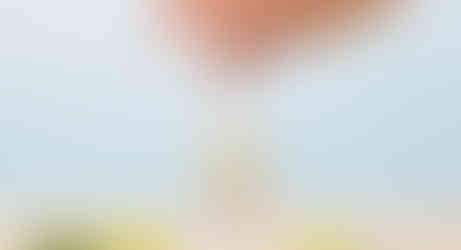















Commentaires